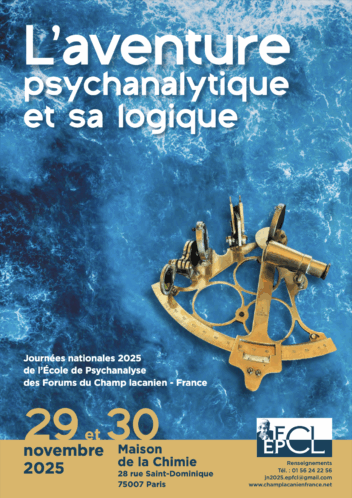L’aventure psychanalytique et sa logique
Argumentaire
La cure psychanalytique, moment essentiel dans le parcours d’une vie, est une aventure dont Freud et Lacan ont démontré la logique. Mais quel rapport entre les méandres imprévisibles de l’aventure et l’implacable rationalité de la logique ?
Du côté de l’étymologie, le mot a sa propre aventure : si adventura signifie d’abord au XIème siècle « ce qui doit arriver », avec l’idée de destin, de fatalité, le mot « aventure » signifiera ensuite « ce qui peut arriver » connotant a contrario le hasard, l’imprévu, les rencontres inopinées, heureuses ou malheureuses, qui déjouent ou bien forcent le destin.
L’expérience de l’analyse combinerait-elle ces deux versants de l’aventure, la nécessité propre à l’ordre symbolique, aux lois de l’inconscient et la contingence où les surprises peuvent advenir au fil de l’aventure des mots ?
L’analysant cherche dans son histoire les évènements, la cause fatidique, les mauvais coups du sort qui auraient déterminé sa vie et ses symptômes. Comment opère l’analyse pour transformer le récit de ces mésaventures en une aventure de discours ? Et quelle logique permet à l’analyste de s’autoriser à embarquer quelqu’un dans cette aventure ? Car s’il participe à ses effets de surprise dès lors qu’il ne sait pas quel désir anime l’analysant, c’est bien lui qui de cette expérience est le garant, et même « l’instrument »[1], permettant qu’elle puisse s’engager, se poursuivre sur une durée souvent longue, et aussi se terminer suivant une temporalité dont Lacan a dégagé la logique.
Freud a inauguré l’aventure en se risquant à interpréter ses propres rêves. Il en a déduit le travail du rêve à partir de la combinaison logique de la matière signifiante qui en fait l’étoffe. Lacan a développé cette articulation en s’appuyant sur Aristote, Pierce, Gödel et d’autres. Il en a construit une logique propre qui jalonne l’expérience d’une analyse au point même d’en réduire le parcours à un processus purement logique centré sur un opérateur, l’objet a. D’où la logique de la cure, celle de l’acte, et celle du fantasme à dégager en fin d’analyse. Le mathème du transfert, l’écriture du discours de l’analyste et les figures topologiques sont autant de formalisations de cette aventure.
Ne négligeons pas le versant plus prosaïque de ce que signifie « avoir une aventure ». L’amour est une aventure et le transfert n’y contredit pas. Freud a fini par lui donner une dimension où l’analyste n’est pas un simple objet d’amour mais participe activement au maniement du transfert. Lacan en a ponctué les étapes logiques jusqu’au terme où s’entrevoit la méprise du sujet supposé savoir.
Et l’expérience de la passe : une aventure ? Sans doute pour les passants qui témoignent, pour les passeurs désignés par leur analyste, pour l’École enfin qui, par ce dispositif, s’ouvre à la possibilité d’accueillir du nouveau pour la communauté analytique au-delà de tel témoignage particulier. Mais à l’aune de ce passage aventureux qui, s’il n’a rien de nécessaire, reste considéré comme l’issue la plus aboutie voire la plus réussie de l’expérience, comment se déclinent dans leur logique les autres types de fin possibles ?
Au-delà de l’intime du cabinet, l’aventure psychanalytique peut s’aborder aussi dans sa dimension historique comme événement daté, avènement de discours qui s’inscrit à un moment précis de l’Histoire conjointement à l’aventure scientifique à laquelle Freud et Lacan étaient très attentifs. Cette aventure est celle de la découverte de Freud, des résistances qu’elle a suscitées, des tâtonnements de l’expérience, de l’élaboration des concepts et de leur remaniement à travers le temps et leur mise à l’épreuve clinique ; c’est aussi celle des institutions psychanalytiques, de leur expansion dans le monde, de leurs conflits internes, des crises et des ruptures qui ont leur logique propre et sont autant de jalons, d’étapes décisives dans cette aventure engagée il y a plus de cent ans. Elle ne peut se concevoir sans référence à d’autres discours dont elle se rapproche, se démarque ou auxquels elle s’oppose. La dimension historique de l’aventure psychanalytique ouvre ainsi la question de son actualité : comment la soutenons-nous aujourd’hui et quelle place reste-t-il à la logique subversive du discours qui l’anime, qui nous anime, où le risque et l’imprévu doivent garder la part belle ?
Commission scientifique
- Vanessa Brassier et Bernard Nominé (Responsables)
- François Boisdon
- Nadine Cordova
- Armando Cote
- Dominique Fingermann
- Dimitra Giannaka
- Corinne Philippe
- Christelle Suc
- Elisabete Thamer
Commission d’organisation
- Dimitra Giannaka (Responsable)
- Zineb Benghadda
- Aurélie Caulier
- Catherine Chauveheid
- Diana Correa
- Mathilde des Déserts
- Christine Eguillon
- Christilla Holtzmann
- Emmanuelle Pajot
- Isabelle Roussin
- Michaela Saporta
- Marcos Vargas
- Charlotte Verger
Programme

Podcast
Abonnez-vous à notre podcast hébergé par SoundCloud ou écoutez les épisodes en ligne ci-dessous.
- « Aventure » d’Agamben (script en PDF) : Un podcast inspiré de la lecture de l’ouvrage « Aventure de Giorgio Agamben. Script – voix : Christine Eguillon-Christilla et Christilla Holtzmann.
- Freud – Ludwig Börne (script en PDF) : Un podcast réalisé par Corinne Philippe avec les voix de Corinne Philippe et Martin Granger, sur l’empreinte de Ludwig Börne dans l’œuvre de Sigmund Freud.
- Freud « en conversation » avec Alfred Maury (script en PDF) : Écho de l’oeuvre de Maury sur L’interprétation des rêves de Freud. Script – voix : Vanessa Brassier – Nadine Cordova.
- L’aventure analytique à l’aune de l’aventure scientifique (script en PDF). Une lecture croisée de Koyré et Lacan. Script-voix: François Boisdon et Bernard Nominé.
Micro-trottoirs
Bibliographie
Informations pratiques
Lieu
Maison de la Chimie, 28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Tarif et inscription
- Tarif individuel en présence jusqu’au 14 septembre 2025 : 145 € (185 € ensuite)
- Tarif Étudiants (-26 ans) / Demandeur d’emploi : 50 € (sur justificatif)
- Tarif Inscrits à un Collège de Clinique psychanalytique : 115 € (sur justificatif)
- Tarif Institutions : 350 € — Numéro de formation professionnelle : 11754119375
Mode de règlement
- Vous pouvez régler, de préférence, par virement bancaire :
- à BRED : N° IBAN : FR76 1010 7001 3700 4120 2069 916
- Merci d’indiquer dans le libellé : « Nom + Prénom + JN 25 + Pole N° »
- Inscription et paiement en ligne : Fin le 25 nov., vous pourrez vous inscrire sur place.
- Par chèque à l’ordre de l’EPFCL – France
- Espèces